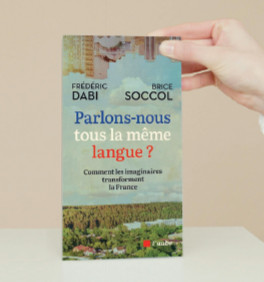Brice Soccol, spécialiste du développement territorial et président du cabinet de conseil Public & Private Link, s’est associé à Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop, pour nous entraîner à la découverte des imaginaires des Français. Ils ont publié le résultat de cette enquête sous le titre Parlons-nous tous la même langue ? (Éditions de l’Aube). Cet ouvrage a reçu au Sénat le prix Edgar-Faure 2024 de l’œuvre engagée.
Propos recueillis par Jérôme Besnard
Article tiré du Journal des Communes numéro 2225 – Les collectivités et le traitement de l’eau
Journal des Communes : Selon vous, l’échelle locale, communale, échappe encore à la défiance qui frappe la représentation politique nationale ?
Depuis plusieurs années, la sphère politique nationale connaît une crise sans précédent, donnant le sentiment de peiner à répondre aux demandes de nos concitoyens, impuissante à transformer le quotidien des Français. Ce sentiment ressenti par de nombreux Français fabrique une profonde défiance matérialisée très souvent par une abstention structurelle. Une défiance qui s’est transformée en colère lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet derniers, après la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République. La France du local a alors exprimé son incompréhension, freinée par le front républicain, laissant une Assemblée nationale plus divisée que jamais. Encore plus aujourd’hui, la sphère du local apparaît comme une valeur refuge, celle de la « promesse politique tenue » et des solutions, capable de transformer le quotidien des Français.
JDC : À quelles attentes renvoie désormais la problématique de la tranquillité chez les Français que vous avez interrogés ?
La notion de tranquillité peut paraître anodine, mais elle renvoie quasi immédiatement à des problématiques collectives et citoyennes, telles que les crises que nous avons dû traverser (crise sanitaire, crise des gilets jaunes, inflation…). Très rapidement les personnes que nous avons interrogées font référence à l’intranquillité, à l’insécurité du quotidien et à la progression de la violence. La sémantique glisse progressivement de l’insécurité à l’impunité, à la défaillance de l’État, illustrée par de nombreux faits divers. Un discours spécifiquement exprimé par les femmes… « On ne sent plus en sécurité en tant que femme ». Si chez les urbains, la tranquillité renvoie dans un premier temps à la notion de calme, de sérénité, d’espace, très vite là encore comme chez les ruraux la notion de tranquillité glisse vers celle de l’insécurité, érigée désormais en préoccupation majeure des Français.
JDC : En quoi la qualité de vie est-elle « la principale clé des habitants pour évaluer leur vie dans leur commune » ? Quelles sont les principales différences dans ce domaine entre citadins et ruraux ?
La notion de qualité de vie est très importante pour évaluer la satisfaction ou l’insatisfaction de nos concitoyens à vivre dans une commune, un département ou une région. Cette notion ne se réduit pas à une dimension financière ; Elle s’articule d’une part dans le cadre d’un rapport coûts/bénéfices (vie personnelle/vie professionnelle, tranquillité/animation) et d’autre part, elle relève d’opportunités d’activités (sportives, culturelles…). Si les ruraux valorisent avant tout des loisirs simples, familiaux, leur qualité de vie est aussi liée à l’accès à internet, longtemps parent pauvre dans les campagnes. Pour les ruraux, la qualité de vie reste associée à une forme de simplicité, alors que chez les urbains, les capacités à avoir du temps et se mouvoir aisément dans l’espace urbain sont des gages de la qualité de vie !
Pour les ruraux, la qualité de vie est associée à une forme de simplicité. Pour les urbains, au temps et à la mobilité.
JDC : Quelle place tient désormais le besoin de services publics chez les Français ?
L’attachement des Français à leurs services publics est très fort, au-delà du clivage droite-gauche. La présence des services publics sur un territoire constitue un puissant levier de réassurance, leur démantèlement, apparaît comme le signe du déclin irréversible de leur commune. Les services publics sont perçus comme un partenaire de confiance avec qui « la relation humaine » reste essentielle : « Dans les commerces de proximité on nous accueille bien, on voudrait que ce soit pareil dans les services publics ». Les citoyens nous renvoient également à la dimension fonctionnelle des services publics, dénonçant dans leur imaginaire une dégradation lente et généralisée des services publics. Cette perception est partagée par les ruraux mais s’inscrit dans une offre de services perçue comme inégale. La réorganisation, leur dématérialisation, une demande mal mesurée comme l’accès aux soins ou la dépendance ont entretenu un sentiment d’abandon. Ruraux ou urbains, droite ou gauche, le maintien et l’accès aux services publics sont une priorité pour les Français.
JDC : Vous soulignez dans ce livre que la notion de famille renvoie à des imaginaires très différents dans les villes et dans la ruralité. Qu’en est-il vraiment ?
La dernière enquête IFOP « Nouvelle vague » menée en 2021 a révélé que la famille apparaissait comme la valeur préférée des moins de 30 ans. C’est chez les ruraux rencontrés que la famille conserve sa dimension la plus « institutionnelle » et traditionnelle. De fait, elle peut alors apparaître comme une citadelle assiégée confrontée aux nouvelles configurations familiales, aux nouveaux modèles éducatifs et à l’individualisme. A contrario les urbains semblent avoir une notion plus étendue de la famille, émancipée des liens de filiation biologique et de la notion d’héritage pour aller vers un choix d’adhésion plus libre et multiforme. Enfin, la question de la dématérialisation des échanges familiaux questionne dans la manière de transformer les liens familiaux.
JDC : De simple témoignage historique et culturel, le patrimoine est-il désormais perçu comme une opportunité de développement économique et social ?
Oui bien évidemment. Le mot patrimoine s’inscrit dans l’imaginaire historique de la tradition, notamment chez les ruraux. Le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel se déclinent sans fin. On parle désormais de patrimoine minier, portuaire, on patrimonialise un village, un fromage, un couteau du Massif central… Le patrimoine est ainsi devenu une valeur, une labellisation de qualité et de proximité, et par là un élément puissant de réassurance sur la « qualité » de son cadre de vie. C’est ainsi comme si le récit national s’était dilué dans le patrimoine, mais il se confond toujours avec l’histoire de la France. Cette notion se voit désormais complétée par celle du patrimoine naturel dont la pérennité est désormais consubstantielle à notre existence.
JDC : Quelle grande leçon tirez-vous de l’écriture de cet ouvrage et de l’enquête qui l’a précédée ?
Si la défiance à l’égard du politique national ne cesse de croître en raison d’un sentiment de déficit de l’action publique, d’une crise du résultat et d’une crise des valeurs, l’action publique locale, permet de matérialiser la « promesse du politique » et de transformer la vie des Français. La capacité des élus locaux à écouter et comprendre le vécu des Français constitue un modèle à suivre par les élus nationaux. Parallèlement, les imaginaires, par leur diversité et parfois leur opposition, peuvent fragiliser l’idée de nation, comme volonté de vivre ensemble. Mais ce livre montre que le temps du dépassement peut arriver, que sur de nombreux sujets ou territoires, la France n’est pas si fracturée que cela et qu’une majorité de Français sont prêts à répondre aux nombreux défis auxquels notre pays est confronté